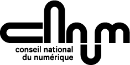IFP : Institut Français de Presse - "Le péril jeune " Etude des pratiques de consommation des films et des séries chez les 20-30 ans, sous la direction scientifique de Nathalie Sonnac
LES RECOMMANDATIONS
1. Considérez le téléspectateur comme un consommateur connecté
Tous les acteurs du secteur de l’audiovisuel -producteurs, chaînes de télévisions et instances de régulation - doivent raisonner sur la base d’un « téléspectateur toujours connecté » : les jeunes adultes (20-30 ans) se divertissent, se cultivent et échangent en ligne depuis leur toute jeune enfance. Ils évoluent tous dans un environnement connecté.
2. Adaptez la Régulation aux pratiques
La politique publique des autorités de régulation doit s’adapter aux modes de consommation des jeunes adultes très « gros » consommateurs d’œuvres. Aujourd’hui, on doit pouvoir :
- regarder des films tous les jours de la semaine,
- accéder à une offre légale illimitée de films et de séries,
- accéder à un catalogue d’œuvres de qualité et largement diversifiés,
- accéder à des œuvres dans des temps très courts.
Si la chronologie des médias est nécessaire, dans son état actuel elle est dépassée, inadaptée voire coûteuse. L’équilibre entre ayant-droit, exploitant et public n’est notamment plus préservé ; la garantie de rémunération des auteurs n’est plus assurée et l’exploitation des œuvres diffusées sur les plateformes n’est plus couverte. Son architecture doit être revue.
La recommandation joue un rôle fondamental dans les modes d’acquisition des films et des séries. Dès lors, la fiabilité des métadonnées, la neutralité des algorithmes, la protection des données personnelles et l’exposition des œuvres sur ces nouveaux services doivent être intégrées dans la réflexion de toute politique publique en matière de régulation. Car une des conséquences majeures de son inadaptation est la conduite inexorable vers un report de consommation, au mieux vers des chaînes ou des services étrangers, ou vers de la consommation illicite.
3. Optez pour d’autres modèles de programmation
Il convient de considérer les jeunes adultes comme des téléspectateurs exigeants, qui consomment illégalement des œuvres audiovisuelles d’abord et avant tout parce que les programmes diffusés ne correspondent pas à leurs attentes.
Il convient de :
- diversifier la nature des programmes diffusés (formats, genres, nombres),
- accéder systématiquement aux contenus en langue originale,
- élargir les moments de diffusion (horaires de diffusion, nombres d’épisodes diffusés, etc.),
- respecter les œuvres dans leur diffusion,
- accroître et amplifier le nombre d’œuvres accessibles en rattrapage et les temps de visionnage doivent être élargi.
Recommandation, partage, collaboration participent aujourd’hui au fonctionnement d’un nouveau modèle de la programmation. Il convient de la concevoir dans un ensemble plus vaste que la seule grille des programmes.
4. Créez des plateformes légales européennes d’œuvres
Les jeunes adultes consomment des contenus sur internet, espace ouvert qui bénéficie d’une offre d’œuvres très largement diversifiée et accessibles quasi instantanément. Ces sont ces critères que doivent considérer d’abord les chaînes dans leur choix de programmation.
La dimension illégale de certaines pratiques n’est pas jugée comme telle par les jeunes adultes, le seul obstacle qu’ils rencontrent dans leur consommation de films et de séries est la difficulté technique d’y accéder, du fait d’une connaissance informatique insuffisante.
Leur consentement à payer pour consommer des œuvres audiovisuelles est positif : ils sont prêts à payer en moyenne 20 euros par mois pour accéder sans ombrages techniques à des catalogues riches et diversifiés.
L’arrivée de Netflix en Europe précipite la création d’une plateforme légale d’accès aux contenus. Jusqu’alors discuter dans le but premier d’affronter et d’enrailler le piratage, la mise en place d’une offre légale rencontre aujourd’hui une concurrence parfaitement légale. Légales, mais pas toujours loyales, les sociétés américaines « optimisent » leurs entrées sur le marché européen en jouant sur ses disparités fiscales. Quelle réponse nationale à l’entrée d’un nouveau « géant de l’Internet et de l’audiovisuel » ? Quelle réponse européenne à l’entrée d’un nouveau « géant de l’Internet et de l’audiovisuel » ? Quel avenir pour les offres nationales et européennes émergentes ? Si la question politique de l’harmonisation fiscale reste centrale, la piste d’une plateforme européenne qui centraliserait les achats de contenus reste à explorer urgemment.