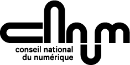« Penser l’État en réseau », entretien avec Sébastien Soriano
Lors d'un échange avec Sébastien Soriano, directeur général de l'IGN, nous avons questionné le positionnement et la coopération entre les institutions et les acteurs non institutionnels dont les pouvoirs ont été considérablement renforcés par le numérique.
Par le passé, Sébastien Soriano a été directeur de cabinet de Fleur Pellerin, président de l’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la distribution de la presse) et a notamment présidé le BEREC (Organe des régulateurs européens des communications électroniques). Il est désormais directeur général de l’IGN (Institut national de l’information géographique et forestière), où il développe une nouvelle stratégie pour l’établissement, celle des « géocommuns ». Il est également l’auteur du livre Un avenir pour le service public, qui interroge le nouveau rôle de l’État vis-à-vis d’un certain nombre de phénomènes dont le numérique
Comment percevez-vous le rapport qu’entretient le numérique aux institutions ?
La question du rapport des institutions au numérique est une très bonne question à défaut d’être une question facile. On arrive à un moment de maturité nouveau, où le numérique n’est plus seulement perçu comme un médium qui facilite un certain nombre de coopérations ou d’interfaces entre les institutions et le public. Mon impression est que le numérique redistribue les capacités institutionnelles. Au fond, il y a des terrains d’actions publiques qui vont être favorisés dans leur capacité à faire institution, et des endroits où les acteurs institutionnels vont être affaiblis et c’est ça que je trouve intéressant.
Le numérique redistribue les capacités « à faire institution ». Par « faire institution » je reprends l’expression de Pierre Bourdieu : « l’État comme banque centrale du symbolique », soit un État capable de créer de la distribution symbolique, que ce soit par la nomination, par les choix ou par les institutions elles-mêmes. Mais alors, comment créer des succursales de cette banque centrale du symbolique ? Des endroits qui sont à la fois autorisés par l’État (par le haut) et qui, par le bas, agrègent de manière plus ou moins formelle des communautés vont être capables de porter des sous-éléments symboliques.
Pour être plus concret, dans les points que je vois être fortement fragilisés par le numérique, il y en a un dont on ne parle pas si souvent, celui de la régulation sociale. Avec les Trente glorieuses, s’est mis en place un système de régulation paritaire avec les syndicats et les représentants patronaux et qui était censé peser dans la vie économique de manière structurante. L’idée était d’avoir un État qui soit l’architecte d’une mise en balance de forces économiques qui s’équilibrent. Cette institution sociale me semble particulièrement en crise avec le numérique parce que l’accélération des rythmes décrédibilise le rôle d’un certain nombre d’intermédiaires dans le maintien de l’équilibre des forces en présence. Le cas emblématique est celui des travailleurs des plateformes. D’une manière générale, le numérique rend inopérant un certain nombre de places de régulation sociales. Ainsi, la régulation sociale est possiblement et malheureusement l’institution la plus fragilisée par l’essor des technologies numériques.
Ensuite, il y a des choses plus classiques, notamment ce qui a trait à l’intermédiation. On voit bien comment le numérique et les réseaux sociaux cassent toute tentative d’avoir un discours descendant, voire une compréhension commune du monde. Le numérique interroge les médias comme organisateur de l’espace public et comme élément fondamental de la démocratie. L’espace public n’est pas une institution, mais c’est un endroit indispensable au fonctionnement des institutions démocratiques et qui est fortement fragilisé et déstabilisé par le numérique.
Enfin, on pourrait aussi s’interroger sur un certain nombre de services publics, qui sont fragilisés par le numérique, mais cela ne relève pas de la définition des institutions au sens de la dimension symbolique de l’expression de Bourdieu et ce n’est donc pas le sujet ici. Il y a par exemple tout ce qui a trait à l’éducatif, alors qu’il s’agit pourtant d’un des modèles de fonctionnement les plus stables depuis le Moyen Âge, voire depuis l’antiquité.
Comment intervient la notion de tribus à laquelle vous vous référez ?
Dans mon livre Un avenir pour le service public, j’ai voulu mettre en avant le « paradigme des tribus », c’est-à-dire la mise en capacité des communautés à s’instituer par des mécanismes d’affiliation libres et ouverts. Ce phénomène est à prendre au sérieux.
L’auto-institution de ces communautés me semble être un mouvement fondamental, qui doit être intégré dans la manière dont on pense l’avenir des institutions. De mon point de vue, tenir compte des tribus, et partant des communs en tant qu’espace auto-institué, est essentiel dans la manière de penser l’avenir des institutions. Toutefois, il est très difficile d’accorder une reconnaissance officielle à ces phénomènes, informels par nature.
Les outils numériques permettent à des communautés de s’instituer par le bas. Par exemple, l’auto-institution des Gilets jaunes ou la mise en place de cagnottes pour soutenir des causes ou des communautés d’acteurs locaux ont été permises par le numérique. De la même manière que la presse a été une technologie absolument fondamentale dans l’émergence des démocraties modernes, le numérique ne crée pas la tribu, il facilite leur auto-institution. Ainsi, internet donne une capacité institutionnelle totalement différente qui va permettre à ces communautés de peser d’une manière plus forte dans le jeu institutionnel et démocratique. Il s’agit possiblement d’un changement de paradigme dans lequel les politiques seraient demain les gardiens des institutions et, en fonction des sensibilités politiques, se porteraient plus ou moins garants de la capacité d’action de tribus portant des petites idées et des petits projets sur un ensemble de thématiques. Cette direction interroge la question du fonctionnement des institutions.
De la même manière que la presse a été une technologie absolument fondamentale dans l’émergence des démocraties modernes, le numérique ne crée pas la tribu, il facilite leur auto-institution.
Au sujet d’une action plus distribuée justement et des manières dont on pourrait changer le système institutionnel, vous développez dans votre ouvrage le concept d’État en réseau. En quoi consiste cette vision de l’État ?
À travers la notion d’État en réseau, j’ai voulu montrer qu’en partant d’exemples concrets, il y a une nouvelle ingénierie publique qui se dessine, qui ne se situe pas au niveau des institutions, mais au niveau inférieur, c’est-à-dire qui touche à la manière de faire fonctionner la sphère publique. Il ne s’agit pas des institutions tenues par le personnel politique, mais des institutions techniques, les services publics, qui sont en fait l’appareil à travers lequel l’État apporte un service, soit l’instrument commun de la Nation.
Ce que j’ai voulu montrer c’est que l’État devait mettre fin à la manière de penser de manière centrale. Il ne s’agit pas de la question de la centralisation ou de la décentralisation vis-à-vis des collectivités locales, mais de revenir sur la logique de l’État stratège développée dans les années 1990 à un moment particulier où l’État n’arrivait plus à gérer les défis des années 1970 tels que la désindustrialisation, l’enseignement de masse, l’exode rural etc. Cette logique reprise dans les rapports Blanc et Picq s’est traduite au niveau international par la doctrine du New Public Management. Elle s’est cristallisée en France par une alliance inédite entre des hauts fonctionnaires qui voulaient faire face une perte de vitesse de l’État vis-à-vis des collectivités locales et de l’Europe et d’autre part un courant de pensée libérale, s’inspirant du mode de fonctionnement des entreprises.
Cet État stratège s’est traduit par de nombreux instruments, dont les plus emblématiques sont la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), les contrats de performance, ou encore l’usage de statistiques de délinquance dans les années 2000. Ce qui dans ce dernier cas a concrètement induit des biais dans les pratiques des agents sur le terrain. Dans ce contexte, se sont aussi développés des mécanismes d’incitations dans la logique de marché telle que le passage à la tarification à l’acte dans les hôpitaux. Cette doctrine a relativement fonctionné dans le sens où elle a permis une relative maîtrise de la dépense publique, mais elle présente des défauts, dont une décorrélation entre l’offre et la demande de services publics. Compte tenu des nouveaux défis tels que l’écologie, des inégalités ou encore de la mondialisation, le rôle de l’État doit être fondamentalement révisé afin qu’il ne soit pas surplombant, mais entraînant.
Un des remèdes aux maux de la démocratie est de mettre du commun dans l’État.
Comment ce nouveau rôle de l’État sert-il un nouveau mode de l’exercice de la démocratie ?
En dehors des questions institutionnelles et de vote, je pense que le remède aux maux de la démocratie, c’est de mettre du commun dans l’État. Au fond, il s’agit de mettre en place une logique de démocratie by design pour faire en sorte que la conduite même de l’action publique s’appuie sur un réseau suffisamment décentralisé d’acteurs qui lui permet d’être de facto guidée par l’intérêt général. Cette démarche n’empêche pas qu’il y ait d’autres garanties institutionnelles par ailleurs, mais ce n’est pas le sujet que j’aborde.
Dans cette démarche, je considère que le déploiement de la fibre à l’ARCEP a été réussi, car il y a eu une forme de démocratie by design à travers la mobilisation dès le départ des écosystèmes locaux, à la fois du côté des élus et des entreprises. Un contre-exemple serait celui du déploiement de la 5G. La feuille de route pour le déploiement de la 5G publiée en juillet 2018 s’est construite suite à la consultation d’un certain nombre d’acteurs : les administrations chargées des télécoms, l’ARCEP, les agences nationales et des acteurs économiques. Au moment où elle est publiée, elle est techniquement pertinente. Toutefois elle ne mentionne pas deux sujets : les enjeux de la cybersécurité pour les objets connectés et les préoccupations environnementales. Il est intéressant de voir que rétrospectivement, les deux sujets qui ont pris de l’ampleur sur la 5G étaient absents de la feuille de route. Pourtant, quand l’ARCEP a organisé en lien avec le Gouvernement le cahier des charges de l’élaboration des fréquences, nous avons auditionné un nombre très important d’acteurs (incluant élus, associations, citoyens au travers de consultations publiques notamment) et personne dans ce cadre-là n’a soulevé comme ce fut le cas par la suite le sujet de l’environnement. Ce qui illustre un impensé global et partagé à ce moment-là.
Comment aurait-on pu faire ? La 5G est opérationnellement portée par un très petit nombre d’acteurs : quatre opérateurs privés nationaux et trois grands équipementiers mondiaux. Se pose alors la question de savoir comment la technologie peut être davantage distribuée en mobilisant les acteurs qui vont la porter au quotidien, acteurs locaux, industriels, fabricants de terminaux, communautés d’usagers, etc. Ainsi, le débat sociétal sur la 5G a été en partie raté. Il était porté par un nombre trop limité d’acteurs, qui n’étaient pas assez représentatifs de l’ensemble des problématiques. Pourtant, il est intéressant de noter qu’au sein même de la famille des télécoms, le sujet environnemental en particulier avait été identifié, mais nous n’avions alors perçu que des signaux très faibles. Comment créer un système capillaire d’acteurs pour tenir compte de ces sensibilités, de manière à ce que les signaux faibles s’expriment by design ?
Selon moi, le renouveau démocratique qu’il faut créer doit permettre de gouverner pour les communs, pour les tribus. De la même manière que Michel Foucault définit l’ordolibéralisme comme le fait de gouverner pour le marché, il faut inventer un gouvernement pour les communs, qui crée les conditions de l’auto-institution d’acteurs qui vont être la société en action, en faisant attention à ne pas trop prédéterminer ces acteurs. Ainsi, les actions menées seront de facto résilientes, car portées par une galaxie d’acteurs. Aujourd’hui, le défi des décideurs publics est d’identifier les tribus agissantes sur lesquelles ils peuvent s’appuyer pour mettre en œuvre une politique.
Vous dirigez l’IGN, domaine de la cartographie qui est bousculé par les géants du numérique, qui est ce que fait Google maps. Comment pensez-vous que ce domaine, au cœur de l’exercice de la souveraineté, va évoluer ? Va-t-il devenir un domaine hybride, un espace commun, complètement privatisé ?
Le domaine de la cartographie est un véritable cas d’école. Il y a une réalité administrative et opérationnelle et une question plus philosophique. Avec la gratuité des données, l’IGN a concrètement changé de modèle économique tout en préservant les enjeux de souveraineté liés à ses missions. Aujourd’hui, le modèle financier de l’IGN ne repose plus sur de la vente de bases de données, mais sur la construction de nouveaux référentiels, plus thématiques pour des acteurs publics. À titre d’exemple, l’IGN produit pour la Direction de l’aménagement du logement et de la nature les données de l’artificialisation des sols, qui avec la loi Climat et résilience va publier un observatoire en la matière. Un autre exemple est celui de l’Office national des forêts, qui est intéressé pour avoir une analyse plus automatique des forêts qu’il exploite ou encore la direction de la prévention des risques afin de faire des analyses fines des bassins versants et mieux prévenir les risques d’inondation.
Se pose aussi une question plus philosophique du rôle de la puissance publique dans l’univers géographique, qui s’est fortement démocratisé ces dernières années. Peut-on se dire que les acteurs privés et les acteurs tels qu’Open Street Map vont s’équilibrer et qu’il n’y a plus rien à faire ? Mon opinion est qu’il y a un vrai danger d’enfermement par les GAFA de notre représentation spatiale. La représentation du territoire me semble être un enjeu de souveraineté. Aujourd’hui je trouve les fonds de carte de Google maps incroyablement pauvres comparés à une carte IGN, parce qu’adaptés à un usage limité. Mais cet usage limité est en train de prendre le dessus et de structurer notre représentation nationale. L’IGN a une histoire militaire et d’une certaine manière l’enjeu guerrier se déplace désormais sur le terrain de la représentation et, en caricaturant, l’ennemi aujourd’hui ce sont les GAFA. Comment y faire face ? Par la coopération avec des communautés ouvertes, telles que le mouvement Open Street Map ou des acteurs de terrain comme les géomètres experts, les services départementaux d’incendie et de secours…
En ce sens, l’IGN a lancé une consultation publique, intitulée IGN et les communs, qui interroge l’écosystème sur les modalités de fonctionnement de cette coopération. Concrètement, il s’agirait d’imaginer, pour des bases de données d’informations géographiques issues de co-productions, une gouvernance ouverte de type « commun » de nature à garantir leur pleine maîtrise et appropriation par la communauté des utilisateurs aussi producteurs et citoyens. À titre d’exemple, ce type d’initiative permet de développer avec l’ensemble des intéressés, tels que les acteurs du vélo ou les municipalités, des référentiels cartographiques navigables pour les itinéraires de vélo. Enfin, un autre sujet est celui des fonds de carte. Aujourd’hui, les fonds de carte d’applications comme Doctolib ou Blablacar reposent sur ceux fournis par Google et cela coûte de l’argent à ces acteurs. L’IGN travaille actuellement sur la valorisation d’un fond de plan gratuit à mettre à disposition de ces applications. Afin de renforcer sa performance, l’IGN a pour ambition de s’allier avec des communautés ouvertes dans une logique d’État en réseau.
Pour aller plus loin :
- Sébastien Soriano, Un avenir pour le service public, Odile Jacob, 2020
- Consultation publique sur les géocommuns de l’IGN, 2021