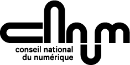Du fonctionnement de l’éducation à la sexualité. Échange avec la DGESCO
Retour sur le fonctionnement de l’éducation à la sexualité et sa dimension numérique avec Claire Bey et Judith Klein, respectivement cheffes des bureaux “santé et action sociale” et “égalité filles-garçons, lutte contre les discriminations, engagement et citoyenneté” à la DGESCO.
Quelles perspectives portez-vous sur l’éducation à la sexualité telle que conçue aujourd'hui dans l’Education nationale ?
Claire Bey (cheffe de bureau de la santé et de l’action sociale à la direction générale de l’enseignement scolaire)
L’éducation à la sexualité est inscrite dans le code de l’éducation : “Une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d'au moins trois séances annuelles et par groupes d'âge homogène.” Ce n’est pas une discipline scolaire en tant que telle et elle a vocation à être portée par l’ensemble de la communauté éducative. Au même titre que les autres éducations transversales, elle ne bénéficie pas d’horaires fléchés a priori mais doit faire l’objet d’une programmation en équipe.
Pour plusieurs raisons liées notamment à la nécessité d’organiser cet enseignement (souvent en co-intervention), de trouver les créneaux et les intervenants, mais aussi au besoin de formation, l’effectivité de l’éducation à la sexualité n’est pas complètement atteinte. Sous l’impulsion de l’ancien ministre de l’Éducation nationale Pap Ndiaye, le Conseil supérieur des programmes a été chargé d’élaborer un projet de programme, avec pour objectif de préciser de manière annuelle pour chaque niveau d’enseignement les attendus en termes d’éducation à la sexualité, de renforcer le développement des compétences psychosociales pour améliorer les relations à soi et aux autres, et d’établir le lien avec les autres disciplines. De nouvelles ressources accompagneront la mise en œuvre de ce programme. Nous travaillons par ailleurs à la réorganisation du portail dédié à l’éducation à la sexualité sur Eduscol avec des entrées opérationnelles par geste métier (“je mets en oeuvre des séances”, “je pilote un projet au niveau d’un établissement” / “au niveau académique”, etc.).
Comment les intervenants en éducation à la sexualité sont-ils formés ?
Claire Bey
Concernant l’Éducation nationale, nous travaillons à la réalisation d’un parcours d’autoformation pour clarifier les objectifs, les enjeux et la réalité de ce que doit constituer l’éducation à la sexualité à l’école (premier et second degrés). Depuis 2021, nous avons organisé de nombreux séminaires nationaux pour faire monter en compétences nos équipes académiques qui pilotent la mise en œuvre de l’éducation à la sexualité dans les établissements de l’éducation nationale partout en France. Ces moments d’échange nous permettent aussi de bénéficier de leurs retours de terrain. En parallèle de formations individuelles, les académies proposent par ailleurs des formations d’initiatives locales lors desquelles un formateur se rend dans un établissement pour travailler avec le personnel pédagogique et éducatif dans la mise en place de programmes d’éducation à la sexualité à l’échelle de l’établissement.
Les partenaires qui travaillent avec l’Éducation nationale constituent des points d’appui importants et réunissent des expertises pointues sur ces sujets. La co-animation de séances personnel éducatif / partenaires peut ainsi s’avérer bénéfique pour les élèves sur certains sujets. Néanmoins, si nous renforçons le travail avec les partenaires, l’éducation à la sexualité doit être portée en premier lieu par le personnel de l’Éducation nationale. Par ailleurs, nous n’avons pas vocation à former ces intervenants extérieurs. Nous disposons en revanche d’un suivi des associations qui bénéficient d’un agrément pour intervenir dans les établissements scolaires, comme par exemple le Planning familial. Nous organisons des rencontres régulières tout au long de l’année avec ces acteurs de la société civile et des temps de bilan annuel sur ce qu’elles mettent en place en termes d’éducation à la sexualité. Ces temps permettent aux associations de nous montrer comment elles forment leurs intervenants pour que nous puissions nous prononcer sur le renouvellement de leur agrément. Nous bénéficions aussi du retour de nos équipes académiques sur la manière dont se passent les séances co-animées. Enfin, nous restons très vigilants au fait que seules des associations agréées puissent intervenir et ce travail partenarial se déroule bien.
Quel regard portez-vous sur les contenus en ligne d’éducation à la sexualité ?
Judith Klein (cheffe de bureau de l’égalité filles-garçons, de la lutte contre les discriminations, de l’engagement et de la citoyenneté à la direction générale de l’enseignement scolaire)
L’exposition des élèves à des contenus d’éducation à la sexualité sur internet est une réalité quotidienne. Leur légitimité pour les élèves questionne la pratique pédagogique et met en lumière une nécessaire évolution des pratiques pédagogiques à l’heure où tant d’informations sont disponibles en ligne. Qui sont les prescripteurs en matière d’éducation à la sexualité sur les réseaux sociaux et leurs propos sont-ils cohérents avec ce que l’institution scolaire entend transmettre dans le cadre de l’éducation à la sexualité ? Comment s’appuyer le cas échéant sur ces contenus pour conduire un travail en milieu scolaire ? Il y a un vrai enjeu d’éducation aux médias et à l’information concernant l’éducation à la sexualité, pour savoir analyser un contenu médiatique, prendre la distance nécessaire le cas échéant avec des discours et des images qui vont à l’encontre du principe d’égalité et de l’exigence de respect des droits de chacune et chacun. Un enjeu, pour l’institution scolaire, serait de produire des ressources d’accompagnement à la mise en œuvre de séances d’éducation à la sexualité articulées avec l’EMI, en travaillant par exemple avec les cellules académiques EMI et les coordonnateurs du Centre de Liaison de l'Enseignement et des Médias d'Information (CLEMI).
Sur les questions LGBT par exemple, on observe un décalage entre les savoirs et la familiarité des élèves avec des notions - souvent acquis à partir de contenus en ligne - et la difficulté à répondre à leurs attentes quand les personnels n’ont pas le même niveau d’information ou la même aisance avec ces sujets. L’enjeu pour nous est de rassurer les personnels sur leur légitimité à intervenir et sur l’importance que les réseaux sociaux ne constituent pas la seule référence des élèves. Sur ces questions en particulier, une actualisation régulière des savoirs par la formation est cruciale.
La parole de figures identifiées, parfois de jeunes adultes s’exprimant sur les réseaux sociaux, peut s’avérer rassurante pour des jeunes qui se posent des questions sur leur identité, sur leur orientation sexuelle et qui ne trouvent pas dans leur groupe de pairs les soutiens et dans leur établissement scolaire l’espace de sécurité qu’il devrait être. A l’occasion de la Journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie, il y a quelques années, nous avons par exemple construit des contenus de communication sur les questions LGBT qui mettaient en scène des youtubers et youtubeuses majeures et déjà identifiés sur les réseaux sociaux pour parler de leur expérience gay, lesbienne, bi-sexuelle, trans (exemple). Ces contenus de communication ont été beaucoup utilisés pour sensibiliser l’ensemble de la communauté éducative sur ce qu’est, aujourd’hui, l’expérience des élèves LGBT.
Claire Bey
Sur le portail Eduscol dédié à l’éducation à la sexualité, nous proposons des liens vers différentes ressources en ligne comme celles portées par Santé Publique France à travers le site onsexprime.fr ou encore les contenus de Sexo Tuto proposé par France Télévisions sur Lumni. De manière générale, nous sommes beaucoup sollicités par des producteurs de contenus : il est bien entendu primordial qu’il n’y ait pas d’intentions commerciales derrière. Nous les analysons pour déterminer s’ils peuvent être valorisés sur Eduscol et éventuellement dans nos parcours de formation et nous restons en alerte sur les contenus qui circulent, certains sont adaptés, d’autres non, et c’est justement là que l’éducation aux médias et à l’information est importante. Nous travaillons d’ailleurs avec le CLEMI sur ce sujet. Nous prenons appui sur ce que les jeunes voient réellement en ligne et cherchons à leur donner des clés pour se prémunir des dangers, qui existent aussi dans le monde physique. C’est aussi pour cela que le développement des compétences psychosociales, parmi lesquelles l’esprit critique, l’empathie ou le fait de pouvoir communiquer de manière efficace, nous semble primordial pour leur permettre de prendre conscience que des publications en ligne ont des impacts hors ligne.
Pour aller plus loin
- Penser la place du numérique dans l’éducation à la sexualité (page regroupant à date l’ensemble des productions du Conseil réalisées sur ce sujet)