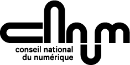« Il n’y aura pas de fin du travail », échange avec Juan Sebastian Carbonell
Juan Sebastian Carbonell est chercheur en sociologie du travail à l’ENS Paris-Saclay, au Gerpisa, groupe de recherches sur l’industrie automobile. Auteur de Le Futur du travail, qui vient de paraître aux éditions Amsterdam, il pense que la fin du travail, régulièrement annoncée, n’aura pas lieu.
Comment êtes-vous passé de l’étude de l’industrie automobile à celle du futur du travail ? Quels sont aujourd’hui vos principaux constats ?
C’est au cours de ma thèse que j’ai été confronté à la question des transformations technologiques au travail pour la première fois. Je travaillais sur un grand constructeur automobile français après la crise économique de 2008, et notamment sur son usine de Mulhouse. Dans les stratégies de sortie de crise, de réduction des coûts et de compétitivité du groupe, figurait la modernisation de l’atelier de montage.
Entre 2014 et 2017, le groupe a réalisé un plan d’investissement assez important dans la modernisation de l’atelier de montage pour mettre en place une “ligne de montage monoflux” qui est capable d’assembler des véhicules de différentes marques et modèles sur une seule et même chaîne d’assemblage là où avant il y en avait deux. Dans cette modernisation, le constructeur a introduit ces technologies de ladite “4e Révolution industrielle“, avec beaucoup de guillemets, qui ont modifié considérablement les conditions de travail des ouvriers du site.
J’ai ensuite souhaité poursuivre ma réflexion autour des dispositifs numériques au travail en élargissant ma focale au-delà de l’environnement industriel, du travail ouvrier, pour m’intéresser plus généralement au futur du travail et aux transformations du capitalisme.
Les conséquences des nouvelles technologies sur le travail ne se réduisent absolument pas à la question de la substitution ou du remplacement.
Le but était de donner à voir à un public plus large une vision différente de celle qui annonce la fin prochaine du travail. Mon livre est paru à la fin de la crise du Covid. Or, cette pandémie a particulièrement cristallisé les débats sur la fin du travail notamment parce que beaucoup de penseurs ou de décideurs affirmaient qu’il fallait pouvoir se passer de salariés sur les lieux de travail.
Je constate à la fois dans mes enquêtes et dans la littérature scientifique qu’il n’y aura pas de fin du travail.
Et pourtant, je constate à la fois dans mes enquêtes et dans la littérature scientifique qu’il n’y aura pas de fin du travail. Les conséquences des nouvelles technologies sur le travail ne se réduisent absolument pas à la question de la substitution ou du remplacement. J’observe trois autres effets : la requalification, l’intensification et le contrôle du travail.
Donc, nous ne nous dirigeons pas vers un remplacement du travail humain par les machines sur les chaînes de montage ?
Il faut faire une distinction très importante entre automatisation et digitalisation. Ce que l’on voit aujourd’hui dans l’industrie et dans le monde du travail en général, c’est davantage une digitalisation du travail qu’une automatisation du travail. La digitalisation concerne l’utilisation massive de données numériques produites souvent par les machines elles-mêmes, qui servent à organiser le travail d’une manière plus optimale et performante. Cela n’implique pas nécessairement l’implantation de nouvelles machines. On voit par exemple l’apparition de logiciels donnant une vision plus générale de toutes les machines connectées au sein d’un établissement : le manufacturing execution system. Ce système permet par exemple de savoir où est-ce qu’il y a des problèmes de qualité, où est-ce qu’il y a des pannes ou encore où est-ce qu’il y a eu des erreurs de production. Du point de vue des salariés, cela implique malheureusement un contrôle plus important de la manière dont le travail est accompli. L’employeur peut savoir plus facilement qui est responsable de quelle faute.
En ce qui concerne l’automatisation, Il y a bel et bien introduction de nouvelles machines dans l’industrie automobile. On voit beaucoup apparaître des automated guided vehicles (AGV), des chariots filoguidés connectés au wifi de l’usine, qui contiennent des capteurs de mouvement, et qui peuvent s’arrêter si un ouvrier passe devant la machine. Ces AGV ont pour mission d’apporter du matériel directement aux ouvriers aux postes de montage pour limiter leurs déplacements.
Il faut savoir que cette automatisation est assez partielle et est toujours réalisée dans le cadre d’une stratégie de réduction des coûts des entreprises. Après la mode de l’automatisation dans les années 1980, beaucoup de constructeurs ont maintenu un niveau d’automatisation relativement bas, voire dans certains cas dans les années 1980 et 1990 ont fait marche arrière. Cela s’explique parce qu’une automatisation trop poussée est parfois un très mauvais modèle économique. L’automatisation n’avait lieu que si celle-ci permettait de réduire les coûts, sauf que ces équipements industriels sont parfois beaucoup trop coûteux pour qu’ils soient rentables. Dans la réalité, le travail humain reste suffisamment peu cher pour qu’il n’ait pas besoin d’être remplacé par des machines, qui demeurent par ailleurs souvent moins flexibles qu’un travailleur humain.
C’est pour cela que beaucoup de constructeurs automobiles, notamment japonais, ont vu dans le lean management – c’est à dire l’implication des salariés dans la ligne de production, un temps de travail beaucoup plus flexible, la polyvalence des salariés qui peuvent occuper différents postes – un autre moyen moins cher pour pouvoir atteindre cette flexibilité désirée dans les années 1990.
Enfin, il faut rappeler que la technologie numérique n’est pas la seule responsable des destructions d’emploi. Ce qui est avant tout en cause, ce sont les stratégies de délocalisation des constructeurs automobiles, afin de réduire leurs coûts.
Qu’avez-vous pu observer en termes de contrôle et de surveillance au travail ?
Le contrôle se décline de deux façons :
- Une première dimension de contrôle liée aux qualifications.
La question du contrôle implique de savoir comment et à quelle vitesse on travaille. Les dispositifs technologiques ont été analysés comme un moyen de déqualifier les travailleurs et permettre aux employeurs d’avoir plus de contrôle sur la manière dont les salariés accomplissent leur travail. Dans un domaine tel que l’industrie automobile, où le degré de qualification était déjà faible, le peu de qualifications qu’il pouvait y avoir est encore plus réduite. L’objectif avec la mise en place des robots filoguidés est de faire en sorte que « n’importe qui puisse faire n’importe quoi », comme me l'a dit un technicien, que les travailleurs deviennent interchangeables.
- Une deuxième dimension de contrôle liée au fait que les outils numériques permettent une surveillance des méthodes de travail
Les outils numériques permettent de savoir où est-ce qu’il y a une panne, qui commet une erreur et donc d’identifier le nom de la personne fautive. Dans les chaînes d’assemblages du secteur automobile, il y a ce qu’on appelle une corde andon, qui peut arrêter la chaîne si un ouvrier voit ou rencontre un problème ou s’il commet une erreur. Il y avait auparavant quelques petits arrangements entre les contre-maîtres et les salariés pour ne pas avoir à tirer la corde, de façon à ce qu’une erreur ne soit pas retenue contre le salarié, notamment à l’occasion de l’entretien individuel annuel. Ces arrangements ne peuvent plus exister car la machine garde en mémoire l’ensemble de ces incidents et de leurs responsables. De la même manière, les machines enregistrent également les heures d'arrivée et de départs des ouvriers, aussi bien qu’elles comptent leur temps de pause.
Si on sort de l’usine, le télétravail a également posé un tas de problèmes aux organisations syndicales, car il est possible pour l’employeur de savoir à quel moment le salarié se connecte à son portail de télétravail. Les dispositifs numériques permettent de contrôler de manière beaucoup plus précise qu’un chronomètre ou qu’une pointeuse dans une chaîne de montage.
Comment ces transformations du travail sont-elles vécues par les travailleurs ?
Si les nouvelles technologies ne sont pas adossées à un projet politique d'émancipation, les effets seront forcément négatifs.
Pour reprendre la fameuse citation de l’historien des techniques Melvin Kranzberg : “la technique n’est ni bonne ni mauvaise, mais elle n’est pas neutre”. Évidemment que les salariés ont une vision critique des nouvelles technologies. Pour eux, la technologie implique bien souvent la déqualification, l'intensification du travail et parfois le remplacement de certaines tâches. Toutefois, les salariés n’ont pas juste un rejet univoque de ces technologies. Ils peuvent voir quelques aspects positifs, notamment le fait que certaines tâches un peu plus pénibles peuvent être prises en charge par ces machines. Cependant, bien qu’ils puissent être soulagés de certaines tâches pénibles, l’entreprise utilise cette libération pour que les travailleurs se concentrent sur les tâches à valeur ajoutée. Ce que décrivent les salariés eux-mêmes, c’est qu’auparavant, le simple fait d’aller chercher des pièces dans l’espace de préparation permettait de faire une micro-pause. Maintenant que les pièces sont portées vers les postes de montage par les AGV, leur activité se concentre et s’intensifie, avec des cycles de travail plus courts et une vitesse de travail augmentée.
Il faut ajouter à cela que la tradition syndicale française est faite de sorte que la négociation porte principalement sur le prix et le temps de travail, et assez peu sur l’organisation du travail elle-même. En réalité, la direction des ressources humaines informe les organisations syndicales des changements à venir mais il y a peu de négociations, contrairement à d’autres pays.
Enfin, si les nouvelles technologies ne sont pas adossées à un projet politique d'émancipation, les effets seront forcément négatifs. Je m’intéresse beaucoup au travail des organisations syndicales et je les pousse à s’intéresser aux nouvelles technologies et à l’organisation du travail. Parce que si quelqu’un sait comment le travail est fait et parfois même ce qui est le mieux pour l’entreprise et pour les travailleurs, ce sont les organisations syndicales.
Dans votre ouvrage, vous parlez du numérique comme “nouveau laboratoire de l’exploitation capitaliste”, qu’est-ce que cela signifie ?
Cela dépend de ce qu'on entend par numérique. Si on parle des plateformes numériques, il y a effectivement un aspect radicalement nouveau, caractérisé par un recours à un management algorithmique impersonnel. La manière dont ces plateformes mettent au travail les salariés en externalisant l’ensemble de la main-d'œuvre constitue effectivement une grande nouveauté.
Pour comprendre le numérique, il faut davantage l'historiciser et comprendre que des formes d’organisation du travail reposant sur une main d'œuvre externalisée par rapport à l’entreprise ont toujours existé. C’est pour cela que certains auteurs parlent non pas d’émergence du travail des plateformes mais de réémergence de cette forme de travail. Par exemple, le tâcheronnat existait tout au long du XIXe siècle. C’était aussi un système où des gens ne travaillaient pas pour une entreprise directement mais pour un preneur d’ouvrage, un intermédiaire qui signait un contrat commercial, et non pas un contrat de travail, avec ces travailleurs. Ce travail d'historicisation permet de comprendre que le travail des plateformes n’a pas quelque chose de fondamentalement nouveau. Le numérique est donc un laboratoire dans le sens où on utilise ces dispositifs technologiques pour mettre au travail d’une manière plus efficace.