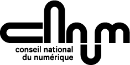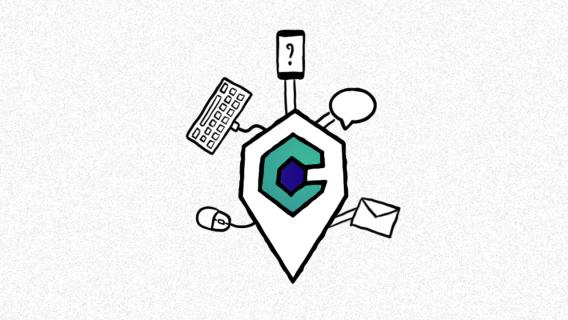Ne pas se programmer aux nouveaux outils. Échange avec Alain Supiot
Alain Supiot, juriste et professeur au Collège de France nous a livré son éclairage sur le rôle des institutions aujourd’hui et leur nécessaire évolution sous l’effet de la révolution numérique. Le texte ci-dessous est une synthèse réalisée par nos soins de cette discussion.
Des institutions en crise
Le sens et l’étymologie du mot « institution » partage une racine commune avec le mot « instituteur ». Ce dernier se distingue du « tuteur », qui sert à représenter quelqu’un qui n’aurait pas encore ou plus la possession de toutes ses facultés. L’instituteur, lui, sert de tuteur uniquement de manière provisoire, car il n’est là que pour permettre à l’enfant d’accéder à une totale autonomie. Si on fait le parallèle, les institutions sont les cadres dans lesquels va pouvoir s’exprimer la liberté humaine. Cette façon de voir les institutions a été profondément remise en cause par l’imaginaire scientiste tel qu’il a commencé à s’imposer dès la fin du XVIIIème siècle - début XIXème. À partir de la fin du Moyen-Âge se construit l’imaginaire de la modernité, qui se représente le monde entier comme une vaste horlogerie, régie par des règles inflexibles. L’être humain est lui aussi naturellement régi par ces mêmes lois. C’est ainsi que l’on va concevoir le travail humain comme l’engrenage d’une machine avec le taylorisme.
Paul Valéry a observé la nature fiduciaire des institutions, qui reposent toujours sur une foi partagée (à commencer par la monnaie !). Elles peuvent apparaître aujourd’hui comme archaïques, étant donné que l’on demande à la science de guider l’action politique. Ce pouvoir des experts n’a fait que croître, avec comme sous-conséquence l’abstention lors des élections. Il ne s’agit plus de prendre appui sur la diversité et l’infinité des expériences de la vie pour s’accorder sur une certaine représentation de la justice. La tâche du politique devient alors de faire de la pédagogie ou de la communication pour faire comprendre aux gens comment fonctionne le monde et ce à quoi ils doivent se conformer.
Les institutions sont les cadres dans lesquels va pouvoir s’exprimer la liberté humaine.
Comme l’a observé le grand mathématicien Alexandre Grothendieck, de nombreux éléments poussent aujourd’hui les scientifiques à devenir de nouveaux prêtres. On l’a vu avec l’expérience de la pandémie : un Conseil scientifique, devenu la source vivante des lois. C’est l’idée que les lois humaines ne sont que l’expression ou la mise en œuvre des lois découvertes par la science. Cette façon de voir est une impasse. Elle méconnaît la spécificité des sociétés humaines, du droit, des institutions, qui fait qu’on ne peut pas les aborder de la même manière qu’un organisme biologique. En outre, la démarche scientifique est menacée à chaque fois qu’elle vient occuper la position d’instance du Vrai, qui, dans l’histoire des cultures, a toujours été une place de nature religieuse. À la différence des vérités légales (par exemple aujourd’hui celle de l’égale dignité des êtres humains, les vérités scientifiques sont « falsifiables », c’est-à-dire qu’elle doivent toujours pouvoir être remises en question pour permettre le progrès des connaissances. Confondre des deux types de vérité – juridique et scientifique – c’est adopter une position dogmatique, ce qui est justement tout le contraire de la science.
Le processus de remise en question des institutions
La dimension hétéronome de l’organisation de la société, c’est-à-dire, la nécessité de postuler un certain nombre de principes sur lesquels nous sommes tous d’accord, et auxquels nous pouvons référer nos actions, est la nature même de l’institution des sociétés. Historiquement, 1945-1946 a par exemple été la réaffirmation de grands principes hétéronomes, à travers la déclaration universelle des droits de l’homme ou la création de l’Organisation mondiale de la santé, de l’Organisation des nations unies ou encore de l’UNESCO. Il s’agit là d’affirmer que le monde doit être régi par des règles adossées à des valeurs partagées.
À un moment donné de l’Histoire, l’art, la science, les techniques et le droit marchent d’un même pas ; ils participent d’un même imaginaire qui marque une époque. Après la seconde guerre mondiale, l’imaginaire de la modernité a évolué avec les travaux de Norbert Wiener, en cybernétique, ou de Peter Drucker, en management. Cette évolution se traduit dans la relation que nous entretenons avec nos objets fétiches, qui sont des objets chargés d’une signification religieuse, que l’on porte constamment sur soi : un chapelet, une kippa… puis, à partir de la révolution industrielle, la montre-bracelet. L’objet fétiche n’est aujourd’hui plus la montre mais l’ordinateur. Chacun d’entre nous se promène avec un ordinateur de poche qui est comme le symbole de son ajustement à l’ordre du monde. Ce n’est pas anodin, car il y a un lien entre la manière dont on pense les institutions et celle dont on se représente le fonctionnement de l’univers.
Chacun d’entre nous se promène avec un ordinateur de poche qui est comme le symbole de son ajustement à l’ordre du monde.
L’impact de l’imaginaire cybernétique sur les institutions
Chaque grande révolution technique s’accompagne d’une révolution des institutions. La question du rapport entre numérique et institutions est donc essentielle ; la révolution numérique est d’une ampleur au moins aussi considérable que la seconde révolution industrielle. Le problème est alors de savoir quelles nouvelles institutions peuvent accompagner cette rupture.
Jusqu’à l’invention de l’éclairage, on ne pouvait pas travailler massivement la nuit. On pouvait certes s’éclairer à la bougie ou avec des lampes à huile, mais cela excluait forcément les travaux dans les champs, etc. C’est donc une impossibilité matérielle qui limitait le temps de travail. Avec l’invention de l’éclairage artificiel, ce qui était impossible devient possible. On s’est donc mis dans un premier temps à faire travailler les gens au-delà des limites de leurs forces, à utiliser des enfants dans les mines etc. Cela a provoqué des conflits, donné naissance à des mouvements sociaux et aux premières lois sur le travail qui apparaissent au XIXème siècle. Le droit du travail est le résultat direct du choc de l’industrialisation. Ce qui était auparavant matériellement impossible est progressivement remplacé par des interdits délibérés qui vont fournir un nouveau cadre spatio-temporel à la vie humaine. Ce mouvement a donné les congés payés et notre « métro-boulot-dodo ».
Ce cadre qui rythme la vie individuelle comme collective est aujourd’hui bousculé par l'apparition des nouveaux outils numériques. Comme à chaque révolution technique, on se met à penser les êtres humains sur le modèle de nos nouvelles machines. L’esclavage consistait à utiliser les personnes comme les animaux, source motrice de l’époque. Le taylorisme pensait les êtres humains comme les engrenages d’une machine - avec cette nuance qu’à l’époque taylorienne, il n’y a pas que des hommes-machines : les intellectuels, les dirigeants, les gens qui réfléchissent ne voient pas leurs conditions de travail différer drastiquement de celles de leurs prédécesseurs. C’est la différence avec la révolution que nous vivons, qui touche tout le monde, dirigeants compris. L’imaginaire cybernétique de la programmation, de la fixation d’objectifs quantifiés dont on mesure ensuite la performance par feedback, a imprégné la manière de concevoir les organisations toutes entières, privées comme publiques. Il concerne toutes les formes de travail, qui doivent être plus que jamais envisagées « au-delà de l’emploi » salarié. En France, l’adoption de la LOLF exprime cet imaginaire d’une gouvernance par les nombres, appelée à régir tous les aspects de la vie publique, y compris par exemple les hôpitaux avec les effets désastreux qu’a révélés la pandémie du Covid 19.
Au-delà des organisations, on se met à penser les êtres humains comme des machines. C’est une erreur grossière de faire le parallèle entre intelligence humaine et intelligence artificielle parce qu’on construit celle-ci sur le modèle supposé du fonctionnement de nos cerveaux. Comme le fait remarquer Giuseppe Longo, un enfant qui a tenu un seul chat dans ses bras n’a pas besoin qu’on lui mette dans la tête des milliers d’images de chats pour les reconnaître. C’est sur la base de cette erreur que l’on s’efforce de programmer les travailleurs, avec force indicateurs de performance, les plaçant dans cette situation pathogène dénoncée par les personnels hospitaliers : « on nous demande de soigner l’indice plutôt que le malade ».
Le problème est de savoir comment mettre nos outils à notre service au lieu de penser que nous sommes fabriqués sur le modèle de nos outils.
L’infantilisation des électeurs et le recours aux techniques de communication, à grand renfort de « nudges » ne peuvent fonctionner sur le long terme. Il s’agit du même type de raisonnement que tient la Cour Suprême des Etats-Unis lorsqu’elle justifie que les multinationales peuvent financer les campagnes électorales sans limites au nom de la liberté d’expression dans une démocratie entendue comme un « marché des idées ». La foi en un « ordre spontané » du marché, auquel chacun doit s’ajuster entretient des liens étroits avec l’intelligence artificielle, comme l’a montré Pablo Jensen dans un livre tout récent. Pour la Cour Suprême, c’est en ayant le plus grand nombre de produits sur le marché des idées que l’on va obtenir la meilleure démocratie possible. Ce qu’il y a de faux dans cette représentation, c’est de confondre le débat démocratique avec une foire d’opinions qui ne peut être qu’une foire d’empoigne où tous les coups (et injures) sont permis, ou bien avec une assemblée de croyants se confortant mutuellement dans leurs certitudes. La démocratie, telle qu’on l’a vu apparaître en Grèce, se définit d’abord comme le lieu où l’on fait cercle et où la parole de chacun est à égalité. Jean-Pierre Vernant a écrit des pages magnifiques là-dessus : chacun fait cercle autour d’un milieu laissé vide. On y pose le sceptre, symbole de pouvoir. Chacun a un droit égal à la parole et peut s’avancer pour saisir le sceptre. À ce moment-là, sa parole devient publique, c’est-à-dire que ce qu’il dit doit viser à approcher un intérêt commun et pas son intérêt particulier.
La démocratie suppose d’éduquer les citoyens à distinguer ce qui relève de leur intérêt privé ou d’une certaine représentation de l’intérêt commun.
À partir du moment où l’on conçoit le politique comme un marché des idées, il faut faire de la publicité pour gagner des parts de marché. Il est évident que lorsque les personnels politiques donnent l’impression d’être animés uniquement par cet objectif, ils perdent tout crédit.
Le lieu du débat est le lieu où l’on va pouvoir confronter une certaine représentation de la vérité. En ce sens, il est comparable à la scène du tribunal ou à l’arène scientifique. Chaque chercheur avance a priori uniquement animé par l’idée d’approcher la vérité. Le discrédit n’épargne pas la parole scientifique, dès lors que la recherche aussi est elle aussi soumise aujourd’hui à la gouvernance par les nombres. Améliorer son score bibliométrique, sa rémunération ou ses capacités de fundraising… tout cela conduit à concevoir la recherche scientifique comme un marché. Il ne faut pas s’étonner ensuite d’avoir des fraudes, dont on constate qu’elles connaissent une forte augmentation. Dès lors, on voit comment projeter le modèle du marché dans toutes les catégories d’activité (recherche, démocratie…) est non seulement un contresens, mais en plus risque de ruiner le marché lui-même.
Les liens entre institutions politiques et institutions économiques
Les idées de démocratie politique et économique sont indissociables. L’idée de la démocratie naît chez le grec Solon, qui va lutter contre les inégalités économiques criantes à Athènes au moment où il accède au pouvoir en donnant à chacun une parcelle de terre pour que les pauvres puissent vivre de leur travail. Ce lien est tout aussi fondamental dans l’invention de nos démocraties modernes, en France ou aux États-Unis. Les révolutionnaires de 1789 n’avaient pas du tout le salariat en tête ! Selon eux, il ne pouvait pas y avoir de démocratie en dehors d’un peuple de petits producteurs indépendants. Montesquieu plaidait en faveur de l’égalité successorale en vue d’assurer la redistribution des richesses à chaque génération et afin que chacun puisse vivre honnêtement de son travail.
L’apparition des sociétés anonymes a été une grande invention juridique, mais aussi une menace potentielle pour la démocratie. À l’image du Golem, il s’agit d’êtres artificiels pouvant se retourner contre les États qui les font naître à la vie juridique. Combinant une puissance économique illimitée et une responsabilité limitée, les plus grandes d’entre elles tendent à dicter leur loi au politique. On oublie souvent que les premières lois anti-trust ont été adoptées à la fin du XIXe siècle aux États-Unis, non pour des raisons économiques, mais pour empêcher les puissances économiques d’imposer leur volonté au pouvoir démocratique exercé par le Congrès américain. Assurer la primauté de la démocratie sur les féodalités financières a aussi été l’un des piliers de la politique de New Deal conduite par Roosevelt, notamment dans le domaine bancaire. On le voit bien, ces questions reviennent aujourd’hui avec les GAFAM. Ce lien entre démocratie politique et économique explique également le succès auprès de nombreux jeunes aujourd’hui du thème des communs, d’entités économiques à taille humaine dans lesquelles on peut discuter de ce que l’on fait.
Les premières lois anti-trust ont été instituées non pas en vertu d’arguments économiques, mais parce qu’il ne fallait pas qu’il y ait de pouvoir suffisamment grand pour imposer sa volonté au pouvoir démocratique exercé par le Congrès américain.
Les appels à un service public citoyen renforcés dans le contexte de la pandémie
Le modèle français est en général retenu pour son stato-centrisme. L’État y joue un rôle très particulier, compte tenu aussi des particularités nationales comme la situation géographique de l’hexagone comme carrefour de populations aux cultures très diverses. Mais on oublie souvent un autre versant de ce modèle : le courant mutualiste proudhonien. Ce courant ne prône pas la suppression de l’État mais se méfie également des excès de sa puissance et des excès des puissances d’argent. Aussi promeut-il ce qu’on appelle aujourd’hui l’économie sociale et solidaire ou une économie des « communs ». Cette idée éclaire les particularités du système français de sécurité sociale. Certes, il s’est inspiré du modèle de Beveridge, dans lequel l’État contrôle tout. Cependant ce que Pierre Laroque, son principal architecte, a voulu construire en France, sous l’égide de De Gaulle, c’était une démocratie sociale gérée par les partenaires sociaux eux-mêmes. L'État ne devrait pas pouvoir faire main basse sur ses ressources. Aujourd’hui, ce modèle a été fortement remis en question et la tendance est à une totale étatisation du système. Cela se reflète d’ailleurs dans les discours publics où on mélange allègrement sous le nom de « prélèvements obligatoires » : les impôts et les charges sociales, oubliant que celles-ci financent solidairement le maintien des revenus du travail face aux principaux risques de l’existence.
Cette dimension du modèle social français est propice au développement de diverses formes de « solidarité civile » entre l’ordre du marché et l’ordre de l’État. Tout cela devrait être une source d’inspiration pour une régulation des données numériques et des réseaux, qui ne devraient se trouver sous la coupe ni des GAFAM, ni directement de l’État, dont le rôle serait d’en être non le gérant, mais le garant du d’un bon usage, respectueux des libertés individuelles et collectives. Mais une telle conception a aujourd’hui beaucoup de mal à se faire jour, notamment au regard du droit européen qui repose sur la dichotomie État/ marché et a poussé par exemple les mutuelles à se couler dans le moule des assurances privées. La pandémie a pourtant montré combien nous avions besoin de ces diverses formes de solidarité civile, tant au plan géographique que professionnel. Faire de l’État l’unique acteur des solidarités conduit à un État obèse et souvent impotent. S’en remettre aux forces du marché condamne à l’entropie.
Pour aller plus loin :
- Alain SUPIOT, La Gouvernance par les nombres, Paris, Fayard, 2015, 2nde éd. coll. Pluriel, 2020
- Alain SUPIOT, Au-delà de l'emploi. Transformations du travail et devenir du droit du travail en Europe (dir.), Paris, Flammarion, 1999 ; 2nde éd., 2016
- Alain SUPIOT, Democracy laid low by the market, Jurisprudence, 2018, 9:3, 449-460
- Alain SUPIOT, Du bon gouvernement de la recherche, Philosophie World Democracy, 7 July 2021
- Alain SUPIOT, Réflexions sur le modèle social français, Entretien avec Arnaud Teyssier, Futuribles, Oct. 2021
- Giuseppe LONGO, Des hommes et des machines : comment reconnaître une caricature ?.in A. Supiot (dir.) Le travail au XXIème siècle. Livre du centenaire de l’OIT, Paris, Éditions de l’Atelier 2019, pp.55-72.
- Pablo JANSEN, Deep earnings : Le néolibéralisme au cœur des réseaux de neurones, Caen, C&F Editions (2021)