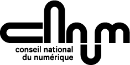Y a-t-il une IA pour sauver la planète ?
Le 7 février 2025, en amont du Sommet pour l’action sur l’IA, le Conseil et neuf partenaires organisaient une édition du Tribunal pour les Générations Futures d’Usbek à la Sorbonne. Alors que nous publions le module IA et environnement de Café IA, retrouvez le livret augmenté de cette soirée.
Un événement au cœur d’une semaine de débats ouverts sur l’IA
Début février, quelques jours avant le début officiel du Sommet pour l’action sur l’IA, toute l’équipe du Conseil national du numérique était mobilisée autour de nombreux événements ouverts à toutes et tous pour penser et débattre de l'intelligence artificielle de manière collective et démocratique. De la matinée “IA : la voie citoyenne” organisée avec et au Conseil économique, social et environnemental (CESE), en passant par le festival Tech&Fest à Grenoble et la journée Compar:ia à l’initiative du ministère de la Culture, ces événements ont réuni près d’un millier de personnes. Ils ont permis d’esquisser les contours d’une technologie pensée pour et par les citoyens.
Point d’orgue de cette séquence : l’organisation d’une édition du Tribunal pour les Générations Futures dans l’amphithéâtre Richelieu de la Sorbonne le soir du vendredi 7 février, en partenariat avec huit institutions publiques et universitaires. La question posée : Y a-t-il une IA pour sauver la planète ?
Le Tribunal pour les Générations Futures est un dispositif conçu par Usbek & Rica permettant de porter la voix des générations futures sur des enjeux sociétaux majeurs, contemporains ou à venir. Ce format reprend les codes d’une conférence en y intégrant la scénographie d’un procès. Il se présente ainsi comme un catalyseur de débat. Un président de séance, un avocat, un procureur, trois témoins et des jurés se prononcent sur scène au nom des générations futures.
Lire le livret « Y a-t-il une IA pour sauver la planète ? »
Tandis que certains défendent l’idée que l’intelligence artificielle est un outil indispensable pour préserver l’environnement, en optimisant les ressources, surveillant les écosystèmes et trouvant des solutions innovantes pour réduire les émissions de carbone, d’autres considèrent que « non, sauver la planète ne se fera pas par la technologie, IA ou pas IA ». Sans compter que l’IA elle-même, avec son coût énergétique et les infrastructures nécessaires à son fonctionnement, pourrait aggraver les problèmes environnementaux qu’elle prétend résoudre en augmentant nos besoins en eau et en métaux rares. La question posée devient dès lors une invitation à approfondir une réflexion cruciale. Où devons-nous mettre nos efforts ? Sur quels points devons-nous exercer notre vigilance ? Quelles doivent être enfin nos exigences, nos ambitions, nos espoirs ? Le débat est ouvert et, tout en permettant aux parties prenantes et aux utilisateurs d’agir, il doit le rester. Car si nous sommes bien sûrs d’une chose, c’est qu’il n’y aura pas de déploiement technologique durable sans un respect profond des exigences démocratiques.

Y a-t-il une IA pour sauver la planète ?
Telle était donc la question posée aux 6 jurés et aux quelque 300 personnes présentes à la Sorbonne pour cette édition du Tribunal pour les Générations Futures. Pour prendre le temps d’examiner toutes les facettes de ce débat brûlant ont témoigné Jacques Sainte-Marie (Inria), Lou Welgryn (Data for Good) et Charles Gorintin (Alan/Mistral), interrogés chacun par l’avocate défendant le « Oui », Adélaïde Barbier, et le procureur défendant le « Non », Blaise Mao. Le tout était coordonné par Lluis Pino, en sa qualité de juge du Tribunal, et rythmé par les croquis acérés de Xavier Gorce.
« C’est un pari risqué sur l’avenir. Pour moi, rien ne permet d’affirmer que la dynamique qui domine aujourd’hui le développement de l’intelligence artificielle – la recherche du profit – sera un jour alignée avec l’intérêt général. Pour l’instant, ce n’est tout simplement pas le cas. » Lou Welgryn

« Il faut remettre les chiffres en perspective. Aujourd’hui, les data centers représentent environ 2 % de la consommation mondiale d’électricité et l’intelligence artificielle seulement 0,1% des émissions mondiales totales. Une part encore très faible en valeur absolue. D’autant que les data centers sont cent fois plus efficaces qu’en 2008, et les modèles d’IA, cent fois plus performants qu’il y a 3 ans. » Charles Gorintin

Le verdict ?
Ce soir-là, c’est le « non » qui l’a emporté avec 53% des voix du public, avec quelques voix d’écart dans une édition particulièrement serrée du TGF. Ce qui témoigne combien les choix de déploiements technologiques ne se feront très probablement que dans une démarche démocratique d'inclusion et de participation des citoyens afin de trouver les réponses les plus opportunes. Un résultat qui n’est pas sans rappeler celui de la consultation réalisée avec Make.org en amont du sommet.
Outre ce résultat, plusieurs pistes sont à tirer des débats qui se sont tenus ce soir-là :
- Nourrir la recherche publique en moyens et orientations nécessaires au développement de technologies choisies et vertueuses.
- Une plus grande transparence des acteurs de l'IA quant à l'ampleur de leurs impacts environnementaux.
- Donner aux citoyens un vrai pouvoir de décision sur les technologies que nous voulons voir, ou pas, émerger.
« Je n’ai pas du tout une confiance aveugle en l’IA. Mais je vous donne deux derniers chiffres, 10 et 2. 10 tonnes de CO2 par an et par personne, c’est le bilan carbone actuel d’un Français. L’objectif de la neutralité carbone c’est 2. Comment on passe de 10 à 2 ? Ce n’est pas en rognant par ci par là. C’est en adoptant quelque chose de profondément transformant. Ce que je défends, c’est que l’IA peut être ça. Je ne dis pas qu’elle sera nécessairement cela. ll faut travailler à ce que l’IA soit ça, un enjeu transformant, dans le bon sens du terme. » Jacques Sainte-Marie
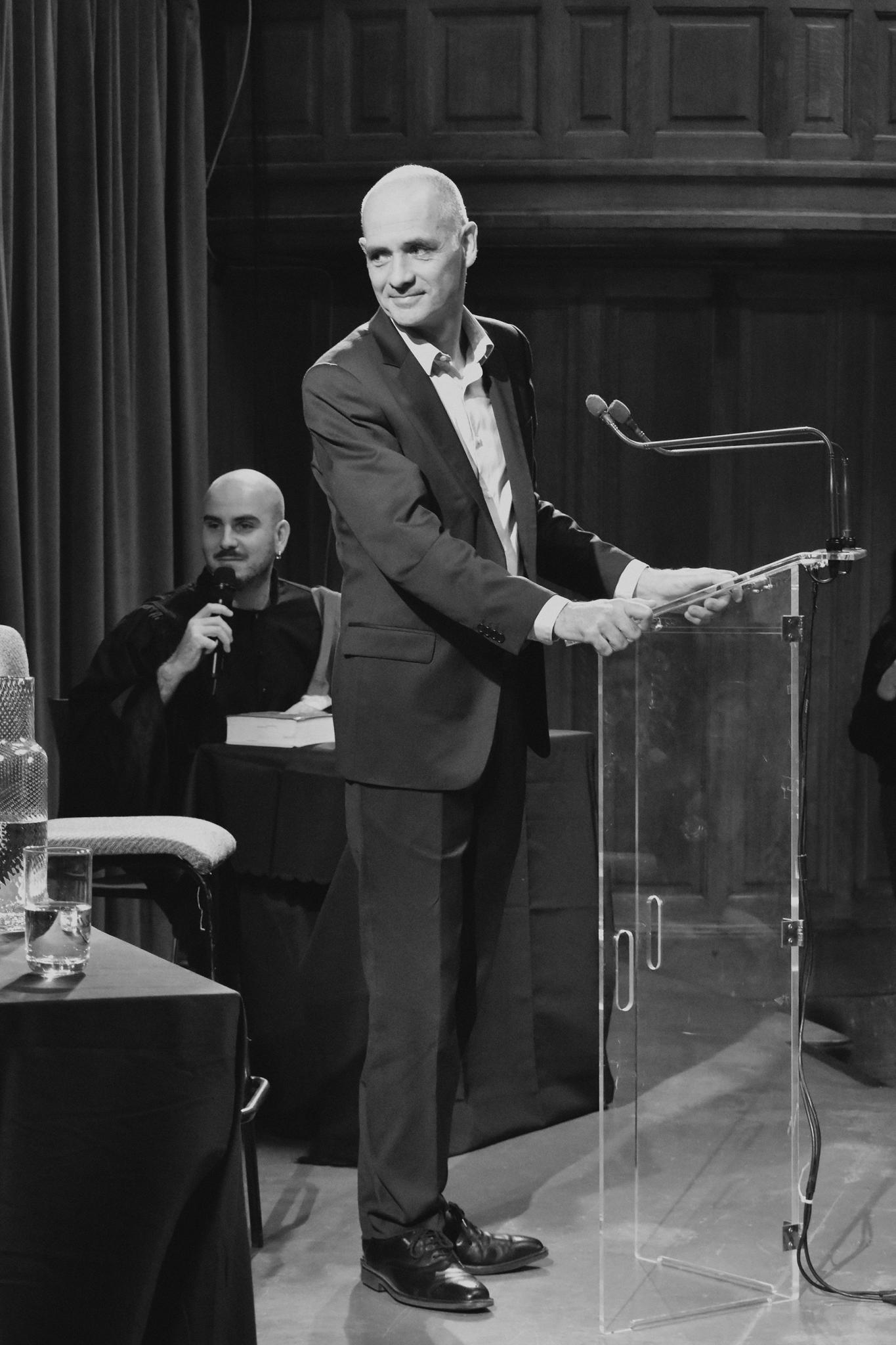
Visionner le replay du Tribunal pour les générations futures
Merci à toutes les personnes qui ont rendu cet événement possible, aux participants pour ces échanges passionnants ainsi qu’à tous les partenaires engagés : l’Agence de la transition écologique (Ademe), l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep), le Conseil économique, social et environnemental (CESE), le Commissariat général au développement durable (CGDD), l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN), Inria, l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (au titre de l’IRJS-DReDIS – Département de recherche en droit de l’immatériel de l’Institut de recherche juridique de la Sorbonne et de l’Observatoire de l’IA) et Sciences Po.
Pour en savoir plus :
Le tribunal pour les Générations Futures était dans la matinale de France Inter, dans La Tribune, dans cet article de la Banque des Territoires et dans Notre Temps, via l’AFP. Découvrez aussi les croquis de Bénédicte Rouiller réalisés pendant la soirée. Jean Cattan présentait également des alternatives aux modèles dominants dans Le Monde tout comme Anne Alombert dans le numéro du Nouvel Obs « Nos vies sous IA ».